Comment éviter que le traumatisme ne devienne un syndrome de stress post-traumatique
Auteures : Debra Kissen et Michelle Lozano
Source : How to Prevent Trauma from Becoming PTSD
Traducteur : Fabrice Aimetti
Date : 18/04/2020
Traduction :
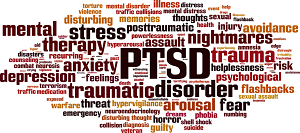
Il n'y a pas de bonne façon de gérer un traumatisme. Chaque individu se déplace à sa propre vitesse et a sa propre aptitude à affronter la douleur et la souffrance.
Malheureusement, il n'existe aucun moyen d'accélérer le processus de guérison d'un traumatisme. La condition humaine est tout simplement difficile et est remplie de souffrances. La bonne nouvelle, c'est que l'intensité de la douleur émotionnelle diminue toujours avec le temps. Il ne s'agit pas d'un sentiment banal, car des études neurologiques ont découvert comment le cerveau fonctionne pour guérir les blessures émotionnelles. Le cerveau est conçu pour survivre et est toujours à la recherche de nouvelles menaces et informations, ce qui signifie que les anciennes expériences finissent par se retrouver en queue de peloton pour guider vos ressources attentionnelles vers ce qui est nouveau et potentiellement important. Mes clients répondent souvent à ce concept en déclarant "Cela ne peut pas être vrai, parce que j'ai vécu cette situation de douleur émotionnelle pendant très longtemps, et mon événement traumatisant s'est produit il y a de nombreuses années". J'explique à mes patients que la réponse naturelle à la douleur émotionnelle est un comportement d'évitement : essayer de ne pas l'avoir, l'ignorer ou la fuir. Cependant, cela permet de garder la douleur émotionnelle active et au premier plan de notre esprit. Ainsi, le cerveau continue à penser qu'il y a une menace active et ces anciennes expériences ne se retrouvent pas à l'arrière du peloton. Le cerveau pense : "S'il n'y a pas de menace, pourquoi s'efforcent-ils tant de ne pas penser ou ressentir quelque chose ? En essayant désespérément de ne pas avoir de douleur émotionnelle, nous provoquons inévitablement des souffrances à long terme.
Des études ont montré une corrélation entre le développement du syndrome de stress post-traumatique et les comportements d'évitement. En d'autres termes, plus on essaie de ne pas penser à un événement traumatisant, de résister à la tentation de revisiter un lieu traumatisant et d'éviter tout contact avec les déclencheurs potentiels de l'événement traumatisant, plus on risque de développer un syndrome de stress post-traumatique.
Il est important de noter la principale différence entre le syndrome de stress post-traumatique et l'expérience d'un traumatisme. Un événement traumatique est basé sur le temps, tandis que le syndrome de stress post-traumatique est un état à plus long terme où l'on continue à avoir des flashbacks et à revivre l'événement traumatique. En outre, pour répondre aux critères du syndrome de stress post-traumatique, il faut un niveau élevé de détresse et de troubles de la vie permanents.
Des études ont comparé des personnes ayant vécu le même événement traumatique, comme par exemple une catastrophe climatique ou un attentat terroriste. Un examen de la littérature sur la résilience et la récupération après des événements traumatisants a identifié les éléments suivants comme facteurs de protection contre le développement du syndrome de stress post-traumatique, ce qui signifie que ceux qui s'y sont soumis n'ont pas éprouvé de souffrance à long terme :
- Un contact et un soutien continus avec les personnes importantes dans votre vie
- Révéler le traumatisme aux proches
- S'identifier comme un survivant plutôt que comme une victime
- Recourir au ressenti positif et au rire
- Trouver un sens positif au traumatisme
- Aider les autres dans leur processus de guérison
- Croire que vous pouvez gérer vos émotions et y faire face
Personne ne peut empêcher la douleur et la souffrance liées à l'expérience humaine, elle est inéluctable. Nous connaîtrons tous des pertes immenses. Ce que nous pouvons éviter, cependant, c'est la souffrance en plus de la douleur. Je raconte parfois à mes patients qu'ils se sont cognés l'orteil et qu'ils sont tellement énervés de s'être cogné l'orteil qu'ils se frappent ensuite le visage.
Vous pouvez vous permettre d'avoir simplement de la douleur et de ne pas souffrir en plus de la douleur en vous ouvrant aux pensées, aux émotions et aux sensations associés à la perte et au traumatisme. Cela ne signifie pas que vous vous laissez submerger ou que vous faites remonter artificiellement des souvenirs et des réactions au cours de votre journée. Au contraire, lorsque ces pensées et émotions pénibles se manifestent, accueillez-les. Je sais que le concept d'accueil la douleur est délicat à saisir. Après tout, qui veut accueillir la douleur ? Mais la douleur est là pour une raison. La douleur que nous ressentons lorsque nous touchons un poêle chaud est là pour nous apprendre que le feu est dangereux pour la peau. La douleur que nous ressentons après avoir vécu un traumatisme est là pour nous guider vers l'avenir et pour voir quelles leçons nous devons tirer afin de nous protéger contre une perte future.
Un exercice que vous pouvez pratiquer consiste à régler une minuterie sur cinq minutes chaque jour. Pendant ces cinq minutes, vous devez vous ouvrir à toutes les pensées, sensations ou émotions associés au traumatisme. Pour mes patients, cela consiste à définir des "heures de permanence", où toutes les pensées, émotions, sensations et images sont les bienvenues. Pendant le reste de la journée, lorsque des expériences personnelles douloureuses surviennent, vous pouvez prendre acte des pensées, des émotions ou des images et leur rappeler gentiment qu'elles peuvent revenir pendant les heures de permanence, mais qu'il y a pour le moment d'autres tâches pour lesquelles vous devez vous rendre disponible.
Agaibi, C.E., & Wilson, J.P. (2005). Trauma, PTSD, and resilience: A review of the literature. Trauma, Violence, and Abuse, 6, 195-216.
Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events?. American psychologist, 59(1), 20.